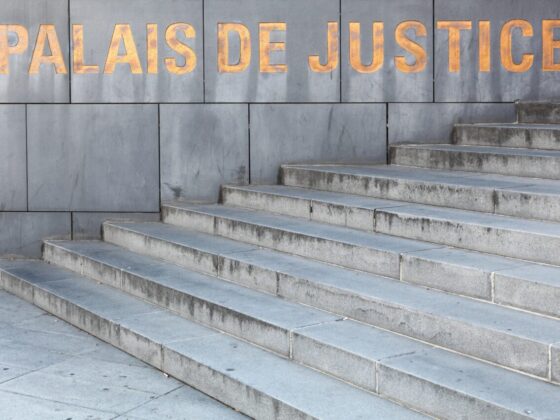Avocat pénaliste: définition
L’avocat pénaliste intervient tant aux côtés des victimes que des auteurs d’infractions pénales, avant, pendant et après le procès. Il conseille son client sur les voies de recours qui s’offrent à lui mais aussi sur la meilleure manière de se défendre au regard de sa connaissance du droit pénal et de sa pratique des juridictions. L’avocat pénaliste élabore ainsi avec son client une « stratégie de défense ».
L’avocat pénaliste doit savoir se rendre disponible rapidement pour fixer rendez-vous, se déplacer au commissariat ou en gendarmerie, au Palais de Justice ou encore en détention. En effet, les délais impartis par la loi en procédure pénale sont parfois très courts.
Défendre c’est enfin convaincre. L’avocat pénaliste est convaincu que la justice fait sens quand elle est tournée vers l’humain. On choisit d’être avocat pénaliste par vocation.
Avocat pénaliste à Paris
Avocat pénaliste à Paris est l’apellation que l’on donne aux avocats pénalistes inscrits au Barreau de Paris et dont le cabinet se situe à Paris.
Les avocats pénalistes inscrits au Barreau de Paris peuvent intervenir devant les juridictions de toutes les villes françaises, le droit applicable étant le même.
Le Cabinet STEIN, avocats pénalistes à Paris, défend ses clients dans la France entière.
Quel est le rôle de l’avocat en droit pénal ?
L’avocat pénaliste doit savoir écouter son client et les personnes qui l’entourent, souvent en situation de total désarroi. Il écoute la peur, l’angoisse, le doute, la peine, l’effroi ou la colère. Pour bien défendre, il faut comprendre.
L’avocat pénaliste informe également son client sur le déroulement de l’enquête et du procès pour donner du sens à la procédure. En effet, une décision incomprise, inadaptée, non-acceptée perd de son sens. Or, ce qui ne fait pas sens n’a pas d’utilité sociale.
Le droit pénal, qu’est-ce que c’est ?
Le droit pénal détermine la nature et le régime des faits qualifiés d’infractions, ainsi que des peines et certaines autres mesures qui s’appliquent aux auteurs.
En effet, l’infraction est une transgression de l’ordre social qui consiste dans le fait pour une personne d’enfreindre ce qui est interdit par la loi sous la menace d’une peine. Cet interdit est classé en crime, délit ou contravention. Ainsi, pour qu’une infraction puisse être reprochée à une personne, il faut qu’il existe préalablement à son geste un interdit et une peine, prévus et définis par la loi.
La justice pénale, qu’est-ce que c’est ?
Les réflexions sur le droit pénal sont le fruit du rejet de la vengeance privée et de l’insécurité qu’elle engendrait. Bien vite, on s’est aperçut qu’il ne suffisait pas que la peine soit juste; encore fallait-il qu’elle soit utile. Il faut punir l’acte davantage que l’homme.
Pour autant, la volonté dépend de la santé, de l’habitude ou des caractères de chaque individu. C’est ainsi qu’est né le principe « d’invidualisation de la peine ». Cela signifie que pour décider la peine, le juge pénal ne considère pas seulement la gravité de l’acte mais aussi l’individu. La peine doit être adaptée à l’individu pour faire sens et par la même être utile au condamné et donc à la société.
Pourquoi choisir d’être défendu par un avocat pénaliste ?
En droit pénal, le libre choix d’un avocat est un droit de nature constitutionnelle dont l’exercice doit être effectif à chaque phase de l’instance pénale par toute personne faisant l’objet de poursuites pénales y compris les mineurs.
L’avocat quant à lui est libre d’accepter ou de refuser de se charger de la défense de tel ou tel client.
S’il accepte de défendre, l’avocat pénaliste s’engage alors à conseiller, assister son client avec humanité et persévérance. Défendre c’est aussi mettre sa connaissance du droit pénal et de la procédure au service de son client, s’informer sans cesse de l’évolution des lois et de la jurisprudence.
Le procès pénal est éprouvant et la procédure pénale de plus en plus complexe. Choisir un avocat pénaliste c’est s’entourer de ses conseils, mais c’est surtout un droit fondamental consacré par la loi.
Avocat pénaliste: formation, études, master ?
Après avoir étudié à l’Université de Droit puis avoir réussi l’examen de sortie de l’Ecole de formation du Barreau – EFB (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat – CAPA), l’avocat pénaliste s’est exercé à la pratique du droit pénal et de la procédure pénale, en effectuant des stages puis en travaillant au sein de cabinets exerçant précisément en droit pénal.